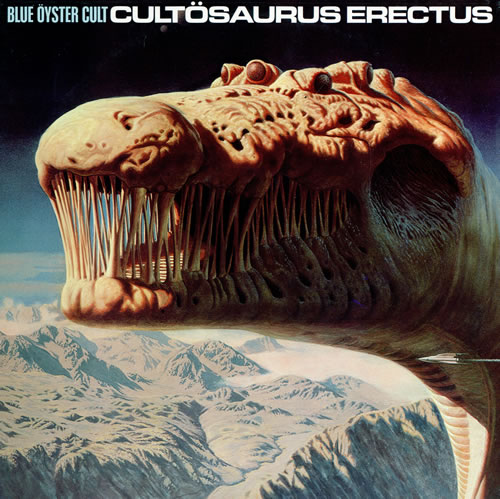Le contexte, parce qu'on aime bien les histoires, que l'on soit enfant ou adulte, puriste de la musique traditionnelle ou non, artiste rêveur ou énarque... et dans ce dernier cas, on n'est pas moins enclin à en raconter que les autres :
Café du Bon Coin s'impose comme le premier album des années 80 dans la carrière des Tri Yann, dont le nom est pour rappel, relatif au fait que ses trois membres fondateurs (et omniprésents) portent chacun le prénom Jean : Jean Chocun, Jean-Paul Corbineau et Jean-Louis Jossic. Tri Yann, trois Jean en brezhoneg/breton. Pour retranscrire brièvement leur histoire commune, ce qui nous est présenté dès leur patronyme comme un collectif de trois membres se voit rapidement amené au nombre de quatre (en comptant Bernard Baudriller, contrebassiste de son état, mais pas que) et les musiciens s'inscrivent en fier Nantais dans le gyron du revival folk celtique breton survenu au début des années 70. Trois albums d'abord purement folk, auxquels succèdera une seconde trilogie d'oeuvres plus rock à la fin de la décennie. Durant les années 80 et pendant une quinzaine d'années, la formation hors trio de tête change de forme (le bassiste Bernard Baudriller s'en va en 1985, le batteur Gérard Goron arrivé en 1976 demeure, le guitariste Jean-Luc Chevalier -ex membre de Magma- arrive en 1991) et ne publie des albums que tous les quatre ou cinq ans. Mais ceux-ci figurent comme les plus étonnants de cette carrière, souvent conceptuels à l'image de l'opéra folk-rock Le Vaisseau de Pierre en 1988 et qui se révèle être un gouffre commercial, le groupe mettant plusieurs années à remonter la pente. Il y arrivera définitivement en 1999, date où il s'adjoint les services du sonneur Konan Mevel, du claviériste Freddy Bourgeois et du violoniste-bassiste Christophe Peloil, développant et stabilisant ainsi le collectif originellement de trois cette fois au nombre de huit (les trois Jean, Goron, Chevalier, Mevel, Bourgeois et Peloil).
Pour l'heure, revenons en 1983. Tri Yann regroupe alors les trois Jean, Bernard Baudriller, le batteur Gérard Goron ainsi que le guitariste Christian Vignoles. Cet album, Café du Bon Coin est donc le premier des années 80, non pas en termes de chronologie stricte, mais d'esthétique musicale. L'échec commercial du disque précédent sorti en 1981, An Heol a Zo Glaz/Le Soleil Est Vert (qui compte de l'avis général parmi leurs plus grandes réussites et est devenu indisponible à la vente au fil des années, ce qui est encore plus regrettable) amène le groupe à changer de formule et à s'adapter à ce qui est alors considéré comme un retour de mode à l'encontre des musiques celtiques. La fièvre du début des années 70, répandue à échelle internationale, a laissé place à la plus grande indifférence de la part du public en ce début des années 80, sauf en Amérique du Nord pour les plus célèbres. Ils sont loin d'être les seuls dans ce cas, mais comme pour Stivell, Servat et tant d'autres, on assiste en cette année 1983 à une profusion de disques made in Breizh fort étonnants (comme le Cola commercialisé depuis en terre d'Armorique, mais c'est une autre histoire).
Ce qui faisait la force de la première décennie du renouveau celtique était une conjugaison de tradition et de modernité, de chants et instruments traditionnels avec des guitares électriques et pour les plus hardis, des synthétiseurs (nom commun dérivé de l'anglais "synthesizer", qui n'est pas une marque de piles ; synonyme du latin "diabolus in musica" et antonyme de "bon goût", surtout du point de vue de nombreuses personnes qui en matière de musique, n'aiment que le rock, le vrai). Les Trois Jean prennent le parti d'étoffer leurs arrangements dès 1976. Urba offrait un son musclé en 1978 (une sorte de hard-rock progressif breton) et donc, An Heol a Zo Glaz, comme pour tant d'autres groupes et artistes tels les Beatles époque Abbey Road, Genesis millésimé Foxtrot, Mike Oldfield avec Tubular Bells et Alan Stivell sur Raok Dilestra, permet à Tri Yann d'exploiter le format vinyle d'une autre manière, rompant ainsi davantage avec l'esprit "collection de chansons" uniforme des premières décennies de ce support (jusqu'à la fin des années 60), et même si en ces années 80 mésestimées, celui-ci n'allait plus tarder à laisser sa place au Compact-Disc.
Avec Café du Bon Coin, le groupe se dégage d'une esthétique courante d'une période, pour permettre à la sienne propre (le folk-rock celtique) de coller avec une autre, celle des années 80. Parmi les passionnés de musique qui ont une certaine tendance à faire preuve de nostalgie (et croyez-moi, j'en connais !), rares sont ceux qui parviennent à digérer cette transition, souvent brutale certes, mais ne forçant pas pour autant à occulter les concessions du groupe lui-même, y compris dans la suite de sa carrière. Car en effet Café du Bon Coin, c'est le même "fond" que les albums précédents, mais avec une réalisation différente et de ce fait, des compositions qui s'adaptent. Une sorte d'échange perpétuel. Chaque album ou presque publié par le groupe depuis le début des années 80 et jusqu'à aujourd'hui prolonge d'une façon ou d'une autre le travail des Urba et consorts, tout en collant avec les possibilités technologiques améliorées au fur et à mesure que le temps passe, sans renier pour autant l'audace (pas plus que les chansons comme “Pelot d'Hennebont” ou “La Jument de Michao” fredonnées en toutes circonstances, que l'on joue avec sa guitare près du feu de camp ou que l'on aille acheter des piles), et encore moins la légèreté ni la profondeur qui elles aussi, constituent un équilibre indéfectible dans la personnalité du groupe.
L'analyse musicologique (qu'il vaut mieux ne pas lire si vous n'envisagez pas de passer votre médaille d'or au Conservatoire, et si pour vous la musique doit rester avant tout un plaisir *rires du public*) :
Café du Bon Coin est enregistré au début de l'été 1983 au Studio des Dames, à Paris, avec le concours des ingénieurs du son Jean-Yves Pouilloux et surtout Henri Lousteau, qui joue d'un peu de violon sur le disque et compte déjà à son palmarès de technicien les premiers albums de Ange, ainsi que le mythique Live à l'Olympia d'Alan Stivell pour rester dans la famille bretonne. Lousteau et Pouilloux proposent donc aux Tri Yann une nouvelle manière de faire sonner leur musique, même si l'investissement vient également des musiciens eux-mêmes, particulièrement du guitariste Christian Vignoles qui contribue aux synthétiseurs (en plus de Guy Battarel, également collaborateur d'Ange à la même époque, décidément...), et de Gérard Goron, qui a acquis une batterie électronique de marque Simmons, le pire cauchemar des défenseurs du rock, le vrai (plus encore que le synthétiseur, c'est possible oui Monsieur Cehef). D'ailleurs, si la musique de Tri Yann est toujours aussi orientée rock, elle gagne en éléments groovy, à grand renfort de funk typique de ces années-là. Un détail particulièrement flagrant sur "La Ville de la Rochelle", ainsi que la grande majorité des moments dansants du disque. Gérard Goron insuffle avec son nouveau jouet une rythmique encore plus tranchante, sur laquelle vient se greffer (pour la dernière fois en studio) la basse de Bernard Baudriller qui slape sans complexe, chose de plus en plus remarquable au fil des précédents albums. Entre force et inventivité, cette section rythmique peut aisément être considérée comme l'une des plus classieuses parmi les formations bretonnes de ces années-là.
Les autres membres ne sont pas en reste, avec un superbe travail de Jean Chocun et Christian Vignoles aux guitares -toujours plus volontairement électriques au fil du temps- et instruments à cordes en tous genres, dans la limite de ceux que l'on appuie sur une seule jambe et que l'on peut porter en bandoulière sans trop d'effort, dulcimer compris. N'oublions pas Jean-Paul Corbineau qui apporte toujours un soutien rythmique à la guitare acoustique, en plus de sa voix d'orfèvre. Une voix qui comme chacun le sait, se réserve les airs, gwerz/complaintes et autres chansons douces entre légèreté et mélancolie, qu'elle caresse de son timbre enchanteur. À l'inverse (et contrairement à un album comme Urba où on pouvait le voir s'essayer au même type de registre que Jean-Paul Corbineau, sur "Francez"), Jean-Louis Jossic préfère tel un lutin farceur les danses, et effets vocaux parfois proches du scat mais cuisinés "à la bretonne", entraînant les autres chanteurs du groupe à sa suite. Il se charge également de la majorité des instruments à vent : cromorne, chalémie et bombarde, tous à l'image de son caractère flamboyant.
Sans vouloir trop rentrer dans les détails, il convient de parler du style, des mélodies... L'habituelle alternance de tempos rapides et de morceaux lents, parfois sans rythme clairement définissable est ici augmentée par la décision du groupe de faire des clins d'oeil plus réguliers à l'Irlande, entremêlés à leurs influences bretonnes natales. Le milieu du disque surtout favorise cette alternance. Pas moins de quinze minutes sont dédiées à Turlough O'Carolan, le harpeur aveugle qui vécut en Irlande à la fin du XVIIème siècle, et grand copain d'Antonio Vivaldi, leurs échanges de l'époque se ressentant fortement dans un style de musique barocco-irlandais inédit ; un disque, appelé O'Stravaganza et entièrement consacré à cette ressemblance, voit le jour par l'initiative de Hughes de Courson, ancien Malicorne, à la fin des années 1990. Après un début marqué par la poésie fragile et contemplative de la musique de O'Carolan, la quatrième plage de Café du Bon Coin propose un medley formé d'une gavotte, puis d'une jig presque complètement fidèle à la tradition (violons, flûtes et percussions ; on croirait entendre un disque des Chieftains !) avant que ne reviennent les éléments funky-rock pour un final de plus en plus endiablé, développé en reel en accélérant comme c'est souvent le cas, de même que pour cette construction globale très courante pour une suite de danses irlandaises. Un peu plus loin, "Irish Coffee / Abigail Judge" préfère une continuité plus linéaire et mise davantage sur les emprunts directs à la musique baroque : on y entend le psaltérion, mais aussi un clavecin électronique qui autant que le violoncelle, tente de se distinguer de l'esprit profane habituel des Tri Yann. Le mode mélodique employé y est un mélange d'aéolien, gamme mineure naturelle aussi présente dans les musiques celtiques, et de la mineure harmonique qui nécessite une sensible, note qui déclenche une tension, et donc par ricochet appelle à un repos sonore. Un choix de composition imposé aux artisans de la musique baroque à l'époque de Vivaldi et O'Carolan (puis ensuite les classiques, etc...) et justement, pour rebondir sur l'argument précédent, dans le but de s'éloigner des modes anciens et des musiques traditionnelles. On peut donc parler si l'on se remet dans le contexte de l'époque, d'un mélange de sacré et de profane. Sachant que le fait d'ajouter des notes "colorantes" à une échelle mélodique prédéfinie, gamme ou mode, est également une caractéristique fondamentale du blues pour revenir à l'échelle moderne. Comme quoi, il y a toujours moyen de cultiver la différence tout en soutenant les rapprochements et de ne pas se snober mutuellement, pas qu'en musique ceci dit.
Mais l'empreinte de O'Carolan contient de toute évidence quelque chose de sacré autant que de féminin, les titres de ses compositions en sont souvent la preuve. On le ressent particulièrement avec les standards "Eleanor Plunkett", "Mrs McDermot" (déjà repris par Tri Yann sur La Découverte ou l'Ignorance) et bien entendu "Planxty Irwin", également réarrangé ici pour le morceau "Kalonkadour". Très folk au début, celui-ci voit son orchestration ponctuée d'effets de synthétiseurs, pour en arriver à ce final où la voix du ménestrel Jean-Paul Corbineau se perd dans la brume, dépeignant le lac de Kalonkadour dans sa quiétude et son enchantement retrouvés. Mais celle que les passionnés des Tri Yann retiennent le mieux dans l'ensemble de cet album, c'est "La Ville Que J'ai Tant Aimée". On est toujours en Irlande, mais dans un contexte plus contemporain puisqu'il s'agit de l'Irlande du Nord et de Phil Coulter, précisément une nouvelle reprise de l'un de ses standards personnels, "The Town I Loved So Well". Sauf que lui la chante en sol majeur ; les Dubliners l'ont aussi faite mais en si bémol majeur, et Tri Yann la transpose à son tour en la majeur. Mais majeur comme une gamme "sacrée" et non comme un mode typiquement celtique, à cause de cette fameuse note “sensible”. La chanson fait plus de six minutes à l'origine, mais les Tri Yann se sont contentés de la moitié et renforcent le côté classisant grâce aux nappes de synthétiseur.
En dehors de l'Irlande donc, la Bretagne est toujours aussi viscéralement représentée et n'a pas à rougir aux côtés de tels arrangements, la diversité y figurant comme point d'honneur. Les harmonies vocales sont davantage mises en valeur, dès le premier titre "Les Programmeurs", au riff de guitare caractéristique du folk-rock breton, appuyé par la mandoline et différents bruitages qui dynamisent le tout en supplément au tandem basse-batterie. Le duo cromorne-violon et les différentes variations rythmiques offrent une continuité aux élans "progressifs" du groupe, mais dans un format propre à la chanson, sans pour autant se faire désirer ardemment par les ondes FM. "La Ville de la Rochelle" n'y tient pas davantage, sans doute par rapport aux ruptures vocales. La gavotte "Aventurou Marian" en kan ha diskan (chant et déchant) va dans le même sens, grâce à un Jean-Louis Jossic ô combien facétieux et un emploi de synthétiseurs-accordéon que l'on retrouvera chez Capercaillie, le groupe emblême de l'Ecosse qui voit d'ailleurs le jour à cette même époque. Les voix "virilisantes" conduisent le tribal "Kan Peoc'h" (aux effets "assénés" de guitare acoustique que ne sauraient renier les Steeleye Span) ainsi que le décapant "Chanson à Boire", où un quatuor de cromornes/flûtes à bec est invité et où l'on revient aux gammes "sacrées" avec la mineure harmonique qui donc impose une dissonance (pour situer, dans le morceau, elle est sur le "-mon" de "poumon").
Mais là où les Tri Yann parviennent à surprendre le plus, c'est au coeur du disque et au moment du final. Premier morceau de l'ancienne seconde face du vinyle, "An Tourter" est parsemé de bruitages menaçants et de cordes de basse claquées, sur lesquels évoluent des séquences rythmiques de synthétiseurs, une batterie aussi lourde et étouffante que l'ambiance. Le tout lancé en bal-plinn dans un esprit de condamnation, renforcé par les choeurs secs et le chant cynique de Jean-Louis Jossic, qui nous suggère le brezhoneg/le breton relevé à la sauce (l'accent) asiatique ! Quant au final de l'album, là encore on y retrouve le côté "classique" du groupe. Comme "An Tourter", la "Complainte de Yuna Madalen" emploie un mode mélodique dorien (très employé dans l'univers celtique pour le coup, écoutez "Mnà na hEireann"/"Women of Ireland", "Tri Martelod"...), avec ça de différence que l'arrangement y fait ressortir les influences médiévales, de manière très élégante et doucereuse. La voix de Jean-Paul Corbineau passée dans un delay (écho), la guitare électrique en son "clean" par ailleurs très présente sur tout l'album donnent ici une ambiance céleste et feutrée, ponctuée de touches féériques par ce qui me semble être un modèle DX7 de chez Yamaha, le synthétiseur le plus courant à l'époque. Cet aspect mi-acoustique mi-électronique, mi-traditionnel mi-variété, sans rythmique et toujours étonnant, se retrouve dans les albums que le groupe corse I Muvrini produit dans l'intervalle 1984-85, pour faire un parallèle avec une autre culture qui veut alors arrêter de survivre et désire vivre. L'instrumental "Les Chevaux du Mene-Bré" (en hommage à l'un des sommets des monts d'Arrée) développe cette fresque enchanteresse autant que troublante, grâce à une fausse harpe et des voix jouées au clavier, un solo de guitare (empreinte de David Gilmour ou Andy Latimer fortement perceptible !) et de puissantes bombardes. De quoi conclure le disque de manière bouleversante par une ambiance toute en amplitude, d'aspect mélancolique -et avec une touche cinématographique-, néanmoins lumineuse. Les mêmes qualificatifs peuvent être employés pour la musique d'Arvo Pärt, à laquelle je pense automatiquement, et bien que l'univers sonore soit ici complètement différent, moins minimaliste. On parlait bien, plus haut, de musique sacrée...
Le résumé de la chronique (que tout le monde peut lire sans problème) :
Café du Bon Coin tient son nom d'un établissement aujourd'hui disparu de Nantes, et qui représente tout un symbole pour les Tri Yann et l'ancienne génération, celle d'un temps que les moins de trente ans ne peuvent pas connaître. Un peu comme cet album d'ailleurs, car en ce qui concerne le groupe nantais et en dehors de ses fans, le public se contente des compilations ou des reprises d'artistes variété actuels. La pochette rouge vif donne un sentiment de chaleur, tout comme le choix du nom, un côté "plaisirs simples". D'ailleurs, l'esprit agréable de ces moments où l'on se détend à une table de bar, le feu crépitant dans la cheminée, est restitué dans des morceaux comme "Irish Coffee". Et le tenancier de vous dire "Vous reprendrez bien un peu de café, juge Abigail ?", ce à quoi, brusquement, vous répondez "Non merci, maintenant c'est la pause chouchenn !". Du coup les copains débarquent, on sort les tables longues en bois et l'on festoie joyeusement, à grand renfort de cervelas et de jambon, comme le veut la "Chanson à Boire". "L'eau ne fait rien que pourrir le poumon, vide-nous ce verre et nous le remplirons !...". Et là comme moi, vous sursautez en vous réveillant car en réalité vous adorez les bretons, les moments de fête, cependant vous ne buvez pas d'alcool par principe (mais n'êtes pas végétarien pour autant), et comme le choc est dur, vous vous enfilez un Doliprane... avec un verre d'eau.
L'album mélange donc à loisir des éléments folk, rock, funk ou pop comme sur "La Ville de la Rochelle" et son côté fabliau, ainsi que sur "Les Programmeurs", satire du métier d'informaticien, de son quotidien oisif et répétitif, qui pousse l'homme à devenir machine à la place de la machine. Ce n'est plus Iznogoud, c'est Inform'attic ou Intern'hot. Le chant en gallo, français déformé caractéristique de la partie est de la Bretagne -sur une carte géographique, c'est grosso-modo à droite de la ligne verticale St-Brieuc/Vannes-, y brille autant que le brezhoneg/breton venant lui de la partie ouest, sur d'autres morceaux. "An Tourter" reprend un poème de Visant Séité, pamphlet à l'encontre des bulldozer et autres instruments de cette torture que subit la nature, les Celtes étant viscéralement attachés à cette dernière. En dépit de la lourdeur du morceau et de l'arrangement contemporain implacable, on sent une grande fragilité dans l'interprétation, au moins autant de tristesse que de colère et pour le coup, le français s'accoquine bien au breton sans pour autant vouloir dire la même chose à l'origine. "Kan Peoc'h", écrit par les Tri Yann cette fois et dont l'équivalent français serait "chant de paix" ou "pour la paix" (je rappelle que je suis provençal, que le brezhoneg/breton n'est pas très courant par chez moi, alors un peu d'indulgence je vous prie), se scinde en deux mouvements chacun constitué de deux strophes, avec les horreurs de la guerre dans le premier, et le désir ardent que l'amour refleurisse -comme la nature- à échelle planétaire dans le second. Ce qui pourrait aisément apparaître naïf à la lecture est contrebalancé par un arrangement tribal, plus rock que le rock français lui-même (ce qui n'est en vérité pas bien difficile, mais non je rigole !).
Le restant du disque est dédié à des moments permettant aux guitares électriques de se reposer un peu, où Jean Chocun et Christian Vignoles dégainent les bouzoukis, mandolines et mandoloncelles, pendant que Jean-Paul Corbineau développe les ambiances légendaires avec sa voix de ménestrel romantique. Des histoires prenantes, qu'elles soient purement imaginaires comme sur "Kalonkadour" (un lac dont la beauté a été altérée et qui dans la seconde partie retrouve tout son éclat et son enchantement) ou plus dans le style "Cette histoire, mes amis, je vous jure qu'elle est vraie !" (à dire avec la voix de Jean-Louis Jossic, et ceci dit elle l'est vraiment !) pour "La Ville Que J'ai Tant Aimée". La ville d'Orvault, en banlieue de Nantes, remplace celle de Derry en Irlande du Nord dans la version originale de la chanson par Coulter et Martin ("The Town I Loved So Well"), et décrit de manière implicite mais non sans détails tristement révélateurs, l'arrivée des anti-démocrates -sous-entendu de droite- à la mairie en ce début des années 80. Entre nombreux clins d'oeil à Turlough O'Carolan, "Irish Dances" est l'une des plages mélangeant plusieurs aspects, folk et rock, tandis qu'à l'inverse, le final du disque adapte les guitares électriques et synthétiseurs à des moments planants, féériques et feutrés.
En tout cela, Café du Bon Coin représente une expérience de choix dans la discographie des Tri Yann. A l'aube d'une époque mais sans renier son passé, l'album est épris de concessions populaires, traditionnelles ou variété, s'orientant vers l'actualité autant que les légendes du côté des textes, et en même temps fait ressortir l'audace et le mysticisme tout aussi chers au groupe. Ce dernier ne mérite décidément pas le stéréotype de simples clowns auquel les puristes le réduisent souvent, et au contraire participe (au présent car quoiqu'on en dise, c'est toujours le cas) considérablement à l'enrichissement du folklore celtique, celui qui depuis alors une quinzaine d'années cultive sa différence en soutenant les rapprochements. Entre Bretagne et Irlande, chaleur et étrangeté, ce disque demeure parmi les plus appréciés et annonce encore énormément de belles expériences, renouvelant un cycle et pas que d'un point de vue musical : il s'agit du dernier album studio en compagnie de Bernard Baudriller, membre fondateur qui part, à la suite de la tournée correspondante, fonder une école de musique à Poitiers.
Par Ma'c